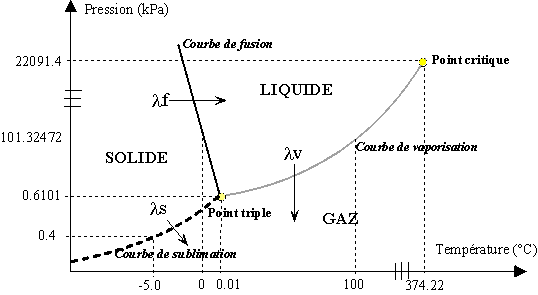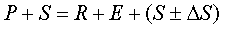Le changement de
phase de l'eau dépend essentiellement de la température et de
la pression mais aussi du degré de pollution de l'atmosphère.
La figure suivante donne les différentes conditions de pression et de
température pour les trois états de l'eau, ainsi que les transformations
de phase.
Fig. 1.3 - Disponibilité
mondiale d'eau.
Tableau 1.1 - Fraction
des réserves totales et des réserves d'eau douce des différents
stocks d'eau de la planète (Tiré de Gleick, 1993))
Tableau 1.2 - Temps
de renouvellement de l'eau dans les principaux réservoirs
(Tiré de Gleick (1993), Jacques (1996))
Tableau 1.3 - Principaux
éléments de la répartition des eaux à l'échelle
du globe
Tableau 1.4 - Bilan
hydrique de la Suisse (données du Service Hydrologique National, 1985)
|
Petite
conclusion sur le cycle hydrologique
Pour conclure sur le cycle hydrologique,
on peut dire qu'il est caractérisé par l'interdépendance
de ses composantes, par sa stabilité et son équilibre dynamique.
Si un processus est perturbé, tous les autres (cycle de l'azote,
cycle du phosphore, etc.) s'en ressentent ! En particulier, le cycle hydrologique
peut être influencé à des degrés divers par
les activités humaines. En effet, l'homme agit directement sur
le processus de transformation de l'eau, et cela de plusieurs façons :
la construction de réservoirs, le transport de l'eau pour des besoins
industriels, le captage des eaux phréatiques, l'irrigation, le
drainage, la correction des cours d'eau, l'utilisation agricole des sols,
l'urbanisation, les pluies provoquées, etc., sont des exemples
de l'intervention humaine.
|
P : précipitations
(liquide et solide) [mm],
S : ressources (accumulation)
de la période précédente (eaux souterraines, humidité
du sol, neige, glace) [mm],
R : ruissellement de surface
et écoulements souterrains [mm],
E : évaporation (y
compris évapotranspiration) [mm],
S + DS : ressources accumulées
à la fin de la période [mm].
On exprime généralement
les termes du bilan hydrique en hauteur d'eau (mm par exemple), on parle alors
de lame d'eau (précipitée, écoulée, évaporée,
stockée, etc.). Cette équation exprime simplement que la différence
entre le débit d'eau entrant et le débit d'eau sortant d'un volume
donné (par exemple un bassin versant) au cours d'une période déterminée
est égale à la variation du volume d'eau emmagasinée au
cours de la dite période. Elle peut s'écrire encore sous la forme
simplifiée suivante :
|
Petite conclusion sur le bilan hydrique L'application
de la méthode du bilan hydrique est limitée par la difficulté
de quantifier les variables. Effectivement, les processus hydrologiques
sont difficiles à observer directement sur le terrain et donc à
mesurer. Notons que les erreurs de mesure éventuelles des termes
qu'on retrouve dans l'équation hydrologique simplifiée se
répercutent directement sur les valeurs calculées de l'évaporation.
Devant ces imprécisions, on suggère l'emploi de cette méthode
dans le cas d'un avant-projet par exemple, pour vérifier l'état
du système et surtout la validité (la fiabilité)
des mesures qui le décrit.
|
 l'évapotranspiration
réelle (ETR) : somme des quantités de vapeur d'eau évaporées
par le sol et par les plantes quand le sol est à une certaine humidité
et les plantes à un stade de développement physiologique et
sanitaire spécifique.
l'évapotranspiration
réelle (ETR) : somme des quantités de vapeur d'eau évaporées
par le sol et par les plantes quand le sol est à une certaine humidité
et les plantes à un stade de développement physiologique et
sanitaire spécifique.  évapotranspiration
de référence (ET0) (anciennement
évapotranspiration potentielle) : quantité maximale d'eau susceptible
d'être perdue en phase vapeur, sous un climat donné, par un couvert
végétal continu spécifié (gazon) bien alimenté
en eau et pour un végétal sain en pleine croissance. Elle comprend
donc l'évaporation de l'eau du sol et la transpiration du couvert végétal
pendant le temps considéré pour un terrain donné.
évapotranspiration
de référence (ET0) (anciennement
évapotranspiration potentielle) : quantité maximale d'eau susceptible
d'être perdue en phase vapeur, sous un climat donné, par un couvert
végétal continu spécifié (gazon) bien alimenté
en eau et pour un végétal sain en pleine croissance. Elle comprend
donc l'évaporation de l'eau du sol et la transpiration du couvert végétal
pendant le temps considéré pour un terrain donné.